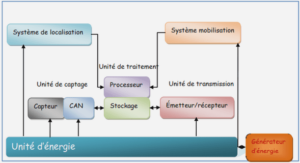Evolution du sujet : du rêve à la réalité
Le projet initial
A l’origine, mon mémoire devait consister en une réflexion sur le réaménagement de l’espace de deux quartiers de Tripoli qui aurait permis de créer davantage de points de rencontres entre les factions rivales, sunnite contre alaouite. Une façon d’ouvrir au dialogue et d’espérer un rapprochement, notamment par le rôle des femmes et de la jeunesse. Les lieux auraient pu être aussi variés que nécessaires, allant de bâtiments culturels à des terrains sportifs. Inspirée des idéaux de l’association Offre Joie, et à l’instar d’une aire de jeux construite durant l’été 2011 à la frontière entre les quartiers, mon projet aurait pris les allures d’un vaste plan de renouvellement urbain où le dialogue et le partage aurait été au coeur du dispositif. La population locale y aurait participé en venant proposer leurs idées, déposer leurs doléances et apporter une main d’oeuvre pour une réalisation future.
Peu de jours après mon arrivée à Beyrouth, j’ai rencontré à l’Institut français du Proche-Orient l’un des membres, particulièrement impliqué sur les questions relatives à la grande localité du Nord. Résidant au Liban depuis plus d’une dizaine d’années et étant marié à une tripolitaine Bruno Dewailly était le premier contact à rencontrer afin de lui exposer mes intentions. Sa réaction a été amusée et il m’a tout de suite mise en garde sur la faisabilité d’une telle entreprise. Ses nombreux travaux sur l’économie de Tripoli lui ont fait prendre conscience des zones d’ombre de ce milieu lié à la politique de la ville, et son expérience m’avertissait de l’utopie patente dans laquelle je baignais. En se quittant, il m’annonçait « je serai curieux de voir ce qu’a donné votre projet après vos quatre mois de terrain… » Il n’avait pas tort d’être sceptique.
Légitimité du photographe et du chercheur
En plus de la rédaction, je souhaitais présenter une série de photographies prises lors de mes voyages au Liban. Cette mise en images de l’environnement aurait permis au lecteur de visualiser concrètement l’ampleur du conflit et les ravages qu’il provoque spécifiquement dans les deux quartiers de mon étude. Mais une fois là-bas, mon avis a évolué en fonction des réalités concrètes. Et c’est une série de questions qui m’est venue à l’esprit : questions de place, de regard, d’utilité. L’apprenti chercheur ne doit-il pas se demander à chaque instant la visée de son travail, le but de sa recherche et la portée qu’elle aura ? En quoi, moi, Clara, étudiante en géographie, serai-je légitime pour immortaliser le quotidien de ces habitants vivant dans le dénuement presque complet ? Mon statut de « chercheuse » me rend-t-il légitime pour aller à la rencontre de ces personnes pour leur demander de poser devant des immeubles en décrépitude, immeubles qui sont les leurs, lieux où ils survivent au cours des rounds ?
Plusieurs raisons m’ont amenée à ces interrogations qui touchent au bien-fondé de ma démarche et à sa recevabilité auprès des populations concernées. Tout d’abord, le contexte en lui-même : la présence de snipers de chaque côté de la ligne de front, de soldats de l’armée libanaise, de chefs de guerre régnant sur les rues, a un effet dissuasif fort pour qui réussirait à pénétrer dans le coeur du quartier armé d’un appareil photo sans carte de presse. Le contrôle social des habitants vivant repliés sur eux-mêmes dans la crainte d’être espionnés joue autant qu’une interdiction solennelle émanant de l’Etat. D’ailleurs, les seules fois où j’ai pu m’aventurer dans Bab el Tebbane tenant ostensiblement ma caméra étaient en compagnie de volontaires d’Utopia, natifs du quartier. Et encore, un papier spécifique, signé d’un des dirigeants de l’ONG, leur avait été donné, au cas où certains leaders refuseraient notre irruption sur leurs terres. Finalement, ces moments, s’apparentant plus à une mission qu’à une visite, se sont déroulés sans encombre mais beaucoup de regards et de questions étaient posées en arabe aux bénévoles sur les raisons de ma présence et mon rôle. Assez rapidement, j’ai fini par laisser tomber mon idée de photoreportage me demandant à quoi allait-il vraiment servir, si ce n’est pour une présentation furtive lors de ma soutenance.
L’absence de visée à long terme, telle qu’une exposition, m’a aussi fait réfléchir sur le voyeurisme du chercheur. En captant des images que je ne diffuserai pas, ni pour dénoncer une situation ni pour faire connaitre au grand public un fait alarmant (ce qui anime le plus souvent les journalistes), n’étais-je pas en train d’outrepasser mes droits et mes convictions liées au respect de la dignité humaine ? Etre partie sur ce terrain miné était déjà une impulsion pouvant s’interpréter comme une forme de voyeurisme morbide, un goût pour le glauque et l’extrême, alors en rajouter avec des mises en scène de la misère c’en était trop pour moi. J’ai donc préféré prendre des clichés précis, qui seraient insérés dans mon travail final en tant qu’illustration utile à la compréhension du lecteur peu coutumier de ce genre de représentations mentales.
Enfin, la dernière raison de ce revirement prend en compte l’usage même de la photographie au Liban et ce qu’elle évoque. L’essor des smartphones est aussi conséquent qu’en Europe, voire plus encore puisqu’il est ringard de ne pas avoir la toute dernière version des mobiles. La génération connectée va de pair avec l’envoi multi-journalier d’instantanés pris depuis son téléphone pour exposer les variations de sa vie, de ses occupations du moment ou de ses humeurs. N’étant pas particulièrement au fait de ces évolutions, c’est au Liban que j’ai appris la nouvelle tendance internationale des « selfies », qui consiste à se prendre soi-même en photo avec l’écran de son portable. Fonctionnant généralement par séries (plusieurs clichés étant nécessaires avant de choisir le meilleur) et le sujet étant toujours le même (le propriétaire du téléphone, quand il n’est pas accompagné de son groupe d’amis), les selfies sont souvent des portraits en plan rapproché (selon la taille du bras) et seuls changent le décor et les habits du jour. A force de me familiariser avec cette pratique dont mes amies levantines étaient accros, j’ai dû revoir les objectifs de mon photoreportage et le mettre en exergue avec ces usages. Ainsi, lorsqu’un Libanais prend la pose, il s’attend à ce que son image atterrisse sur les réseaux sociaux afin que ses amis puissent la commenter ou la « liker ». Il doit donc être en représentation pour que sa réputation ne soit pas ternie par une posture disgracieuse. Alors que je doutais déjà de la légitimité de mon projet, cet ultime argument a fini de me convaincre que je n’avais pas ma place en tant que photoreporter dans ces quartiers.
Finalement, au lieu de m’entêter à montrer ce qui ne va pas, ce qui fait verser des larmes et qui émeut le spectateur, j’ai voulu dévoiler ce qui va bien et qui est porteur d’espoir dans un espace pourtant en proie à un conflit durable. C’est pourquoi j’ai profité de l’organisation par l’association Utopia d’une grande kermesse avec les enfants du quartier sunnite pour ressortir mon appareil et immortaliser les sourires et la joie de ces gamins ayant vécu le pire mais gardant toujours leur innocence et leur spontanéité dès lors que des jouets sont mis à leur disposition. C’était mon moyen d’expression à moi de rendre hommage à ces personnes qui, bénévolement, cherchent des solutions pour rendre moins morose le quotidien de ces chérubins qui ne perdent pas l’ambition de s’en sortir. C’était aussi ma façon de dévoiler le beau derrière ce qui a été brisé.
Les désillusions
Dureté de la vie quotidienne
Arrivée pleine de bonne volonté le 12 février 2014 à Beyrouth, j’avais cru m’être suffisamment bien préparée mentalement pour m’éviter de rentrer trop meurtrie par ce terrain que je savais miné. Depuis deux ans je lisais très régulièrement L’Orient-Le Jour et The Daily Star Lebanon, deux journaux nationaux libanais, et plus attentivement encore la rubrique consacrée aux combats à Tripoli, ainsi que les informations concernant la guerre civile voisine. Je passais plusieurs insomnies nocturnes à me projeter ce que je pourrais voir là-bas, à me mettre en situation, à envisager tous les scénarii possibles (mon activité cérébrale est particulièrement imaginative…). De plus, le projet qui me trottait dans la tête de devenir reporter de guerre m’assurait que je faisais là le bon choix : commencer par une zone pas trop dangereuse, ensuite je verrai bien. En effet, j’ai bien vu… bien que je n’aie rien vu de traumatisant en soi !
Parmi les plus marquantes désillusions qui m’ont rendu la vie dure au Liban, ce ne sont pas les traces directes du conflit qui l’emportent. C’est au contraire, tous les à-côtés qui, pris séparément, n’avaient rien de heurtant mais qui, mis bout à bout, devenaient un supplice à entendre ou à regarder. Par exemple, la vie quotidienne des femmes avec qui je logeais dans un foyer me laisse quelques souvenirs nauséeux. Je les revois me parler de leur village natal dans les montagnes à la frontière syrienne où se passent des atrocités innommables dans des camps de réfugiés, ou encore me raconter la tension qui règne dans la voiture au retour de week-end lorsqu’elles patientent dans les embouteillages au niveau des deux quartiers ennemis, un point rouge de sniper virevoltant sur la carrosserie et le pare-brise, ou enfin les photos de Homs, la cité natale d’une étudiante syrienne venue terminer son cursus à l’abri, en m’expliquant que nombre de ses amis y ont été tués « les mains vides » (autrement dit, ils n’étaient même pas des combattants). Ce sont aussi les mauvaises nouvelles accumulées qui rendaient chaque jour plus sombre, des nouvelles qui ne me concernaient pas mais que l’on me racontait, que je recevais comme des piques toujours plus acérées. L’une de mes premières désillusions a donc été de subir les désillusions des autres, leur résignation à porter la guerre, celle des autres mais qui les concerne tous. La résignation à ne plus croire, à se rassurer en déclarant avec entrain « C’est le Liban ! On n’y peut rien ! ».
Organisation de la vie sur place
L’engouement de mon projet de départ a lui aussi été mis à mal rapidement par la réalité du terrain. Je suis arrivée à Tripoli entre deux rounds, pas de tirs de kalachnikovs qui planaient mais toujours cette haine fratricide qui divise les deux quartiers. J’avais pour projet de réfléchir à des lieux de rencontre entre les communautés, d’ouvrir le dialogue… de forcer la paix finalement. Mais une maîtresse qui oblige deux enfants à toper dans leur main ne gagne pas la paix des âmes, elle apaise sa conscience d’avoir accompli l’action qu’il fallait faire en pareil cas plus que celle des deux adversaires qui se sentent incompris et gardent en eux leur rancune. Après des semaines de déambulations, j’en ai conclu qu’il était vain de vouloir l’apaisement, le rapprochement, voire la réconciliation. A quoi bon les rendre amis puisqu’ils se détestent ? Le conflit est bien trop actuel pour espérer en tirer quoique ce soit de positif, chacun gardant en soi des rancoeurs et des plaies béantes. Nouvelle désillusion donc de se sentir impuissante et inutile. Avant mon départ, j’avais rencontré à Paris F. Ballif, urbaniste, spécialiste du conflit en Irlande du Nord. Ce qu’elle m’avait raconté sur les Peacelines (ou Murs de la paix) à Belfast me revint alors et, regardant de part et d’autre de la rue de Syrie j’ai murmuré : « Mais qu’ils en construisent aussi ici ! ». La résignation que je craignais par-dessus tout – la mienne – m’envahissait. Peut-être étais-je enfin en train de comprendre le ressenti et le cynisme des Libanais ? Peut-être étais-je enfin en train de saisir la complexité des conflits, quels qu’ils soient, à travers le monde ? Peut-être étais-je enfin en train d’assumer que je n’étais pas toute puissante ?
Retour à Paris
Cinq semaines seulement après mon envol vers le Liban, je rentrais à Paris. Trop durs, la vie là-bas, la condition des réfugiés syriens omniprésents, la reprise des affrontements entre Bab el Tebbane et Jabal Mohsen, les salves des kalachnikovs, l’idée que chaque balle arrachée au lourd chargeur est susceptible de tuer quelqu’un, les tirs de roquettes et des tanks de l’armée, les messages de mes amies habitant à une dizaine de mètres de la ligne rouge pendant que les déflagrations reprenaient.
Trop dur d’être née en France et de ne jamais avoir connu de guerre autrement que par les films. Je devais rentrer dans mon pays de Bisounours, revoir du rose, recommencer à espérer. Au moment d’acheter mes billets, j’ai hésité à prendre un trajet Paris-Beyrouth, je m’y suis forcée, autrement je n’y serais pas repartie. Ce retour de deux semaines m’a permis de revivre normalement, de me promener dans les rues sans craindre d’entendre une cavalcade de bordées meurtrières. Je sursautais au moindre choc, mais j’étais en France, dans ce pays où la fusillade de Charlie Hebdo et les attentats de Paris n’avaient pas encore eu lieu, où le pire encouru restait à la cheville des exactions perpétrées à la frontière syrienne.
Mais le retour ne se vit pas si simplement, il y a d’abord le décalage entre les deux mondes, l’incompréhension de ceux qui ne l’ont pas vécu et qui ne peuvent se le représenter. La culpabilité aussi d’avoir le passeport européen, de pouvoir rentrer quand bon me semblait et de laisser mes amies sur place, elles qui vivent pourtant ce calvaire depuis trois années. C’est un sentiment, me semble-t-il, inévitable dans pareil moment, alors qu’il ne fait qu’accroître les différences entre celle qui est « bien née » et celle qui ne l’est pas. Autrement dit celle qui a eu la chance de voir le jour en Occident et celle qui doit grandir dans un climat de violence quasi quotidienne. La culpabilité d’être née du bon côté de la barrière, de pouvoir la sauter par un simple échange d’argent et, par cette furtive transaction virtuelle, de le faire sentir à l’autre.
L’apaisement des tensions grâce au plan de sécurité
Alors que je m’avouais vaincue d’avoir cédé à la pression, que j’admettais ma vulnérabilité et dévoilais aux yeux de mes proches ma sensibilité, ces quinze jours de détente ont été une aubaine. Non seulement je repartirais à Tripoli consciente de ce que j’allais y voir, ôtant ainsi tout angélisme de mon esprit, mais plus encore, un évènement inattendu a changé le cours des choses.
Le 21ème round, commencé peu de temps avant mon départ, dura une dizaine de jours, faisant 27 morts et des dizaines de blessés. Pour le Président libanais Michel Sleiman « l’insécurité à Tripoli n’est plus acceptable et nécessite une solution urgente »48. Après trois ans de friction entre les deux bêtes noires du pays, le Conseil des Ministres se décide enfin à agir avec fermeté pour redresser l’état de la capitale septentrionale. Dans ce but, de nombreuses prérogatives ont été accordées à l’armée, notamment en termes de perquisitions et d’arrestations des membres actifs des milices sunnite et nusayrî. Dans le même temps, une roquette a tué un enfant et blessé une personne, un soldat ainsi qu’un fonctionnaire ont été assassinés, ceci dans le but de « replonger la ville dans un nouveau cycle de violence, afin de faire avorter le plan de sécurité avant même sa mise en oeuvre », hypothèse diffusée par des sources non-citées dans l’article du quotidien Al Manar. Celles-ci auraient « pointé du doigt des groupes takfiristes, dirigés par certains cheikhs extrémistes de la ville, parmi lesquels figure Salem al-Raféï, qui s’était publiquement attaqué à l’armée libanaise ». Les heurts entre les factions sunnites et les forces blindées sont fréquents depuis que la rue de Syrie et les points d’accès des quartiers Est sont contrôlés par l’Etat, mais les mesures coercitives annoncées devraient mettre un frein aux affrontements si les infiltrations dans les caches des rebelles ont permis de les désarmer, au moins pour un temps.
Revirement final : en finir avec le ‘monde de Bisounours
Début avril, me voilà de retour à Tripoli, prête à reprendre ma recherche de façon plus apaisée et lucide sur les suites de mon projet. J’en avais fini avec l’idée de réunification, trop utopique et décalée. Désormais, j’axerai mon étude sur le travail de ces associations déjà contactées qui oeuvrent quotidiennement à la survie de leur quartier. Avec des moyens financiers limités mais une armada de bénévoles prêts à s’engager, ils réussissent à garder l’espoir et ne se laissent pas envahir par la résignation que trop de Libanais, et moi-même il fut un temps, endossons comme un bouclier de protection. Se désinvestir de ce conflit c’est choisir de ne pas le voir pour ne pas le subir. Comment reprocher cette attitude à ceux qui clament en choeur « C’est le Liban ! » ? Dans des conjonctures extrêmes telle que celle au Nord, chacun tente de se construire malgré tout, coûte que coûte. La résignation est l’option qu’ils ont élue face au dilemme du carnage.
Pour ceux qui le vivent de plein fouet, l’étau se resserre et les alternatives sont moins attractives. Beaucoup de jeunes prennent les armes pour venger leurs pairs, empocher les quelques dollars qui leur sont reversés par les chefs de milice et jouer à la guerre comme ils l’ont vu faire par leur père lors de la guerre civile, leur grand frère ou leur héros de film d’action. Une bonne partie, surtout les mères, attendent que le nuage passe et prient pour que demain inch’Allâh le vent tourne. Enfin, d’autres veulent être actifs pour le rétablissement de leur quartier et rejoignent des associations. Quelques-uns profitent de leur instruction pour donner des cours de remise à niveau scolaire, d’autres prêtent leurs bras à des chantiers de reconstruction. Tous ne croient pas en une paix prochaine, mais participent, à leur façon, au maintien de la vie quotidienne, à tout prix. C’est de ces petites mains, ces porteurs d’espérance, dont j’ai voulu parler ici, pour que leurs actions dans l’ombre soient un exemple pour tous.
Tentative de comparaison avec le conflit nord-irlandais
Les raisons de ce choix
Une année entière s’est écoulée sans que mon étude ait vu le jour – j’en ai déjà expliqué les causes. Alors, profitant de l’été à venir, j’organise un nouveau départ. Vers l’Irlande du Nord cette fois. Le choix de cette destination fait échos à plusieurs raisons. Premièrement, l’écrivain et ancien reporter de guerre Sorj Chalandon a sorti en 2013 un roman intitulé Le Quatrième mur, qui raconte l’histoire d’un metteur en scène qui va tenter de monter la pièce Antigone de Jean Anouilh au Liban, en plein coeur de la guerre, où chaque personnage serait joué par un membre d’une communauté différente. Le roman, ne se contentant pas d’être écrit avec un réalisme poignant (l’auteur a vécu les massacres des camps palestiniens de Sabra et Chatila), commence et finit à Tripoli. Un rappel de ma propre histoire qu’il aurait été difficile de nier ou d’y rester indifférente. Après cette première rencontre littéraire, j’ai lu deux autres ouvrages de lui, Mon traître et Retour à Killybegs qui se déroulent dans le Belfast de l’IRA au cours de la seconde moitié du XXème siècle. La justesse de l’écriture et la complexité du sujet (pactiser avec l’ennemi pour obtenir la paix est-il une trahison de son propre camp ?) m’ont donné envie d’aller découvrir par moi-même les traces restantes de cette lutte, mise en berne depuis une trêve contestée à partir de 1997.
Par ailleurs, mon rendez-vous avec F. Ballif à l’Institut d’Urbanisme de Paris m’est revenu en tête alors que la question de la ségrégation physique des partis fratricides m’occupait l’esprit. J’avais vu les ravages que fait un conflit non-contenu et je me demandais si la présence d’un mur de séparation sur la rue de Syrie pourrait avoir un rôle positif dans les circonstances actuelles. Il me fallait donc aller voir de plus près comment et pourquoi les Peacewalls avaient été érigés et comprendre leur utilité au moment de leur construction.
En outre, j’étais curieuse de m’aventurer sur des positions qui ont également subi des affrontements intercommunautaires, entre chrétiens. Ce ne sont plus deux communautés musulmanes mais une, majoritaire, protestante – pro-gouvernement britannique – et une, minoritaire – favorable à l’indépendance de la République d’Irlande en 1921 et qui se revendique comme en faisant partie. La religion reste au coeur des revendications, or ce sont des intérêts politiques et des luttes de pouvoir qui tirent les ficelles de ces affrontements.
Enfin, la gestion post-conflit et les solutions mises en place pour préserver l’équilibre du cessez-le feu m’ont décidée à reprendre la route et à tenter une comparaison entre ces deux pays que tout oppose à première vue, (continents différents, confessions différentes, cultures différentes, époques différentes).
Similitudes non-exhaustives entre Belfast, Londonderry et Tripoli
Loin de moi l’idée ni l’envie de faire une comparaison détaillée entre ces deux conflits survenus à quelques décennies d’écart. L’objet de cette partie est simplement de présenter une autre façon de gérer une situation de guerre, notamment en cherchant à voir comment, à travers le monde, un même évènement peut être magnifié par des petits détails analogues. Et enfin, le conflit nord-irlandais ayant abouti à des accords de paix, il est intéressant d’interroger leur efficacité afin de les transposer sur celui en cours.
Un conflit intercommunautaire
Ce qui a été a posteriori qualifié par le terme ‘the troubles’ fait référence à une période de vive agitation en Ulster, l’une des quatre provinces de Grande-Bretagne, située sur l’île d’Irlande, à partir des années 1970 et jusqu’à l’aube du XXIème siècle. Les raisons historiques remontent au temps de la colonisation en 1800, lorsque qu’Anglais et Ecossais débarquent outre-mer. Ces derniers, majoritairement protestants imposent leurs rites aux dépens de la religion catholique. Une première guerre civile éclate en 1919 qui se conclut, deux ans plus tard, par le Traité anglo-irlandais qui accorde l’indépendance à la République irlandaise mais conserve la partie circonscrite au Nord afin d’avoir un pied sur ce territoire.
Avant qu’un nouveau cycle de violences ne survienne, l’Ulster comptabilisait 54% de protestants contre 41% de catholiques sur une population d’1,5 millions d’habitants. Mais les premiers arrivés n’étaient pas résolus à se laisser humilier par les vainqueurs qui jouissaient de droits plus importants. C’était le cas notamment de la campagne pour le droit de vote dite « un homme, un vote » car le système en place posait comme condition nécessaire le fait d’être imposable, ce qui était rarement le cas chez les catholiques généralement pauvres. Des discriminations liées au logement ou à l’embauche creusaient un fossé toujours plus encaissé entre unionistes (protestants) et nationalistes.
Le « Bloody Sunday », survenu le 30 janvier 1972, qui a coûté la vie à 13 manifestants pro-Irlandais lors d’une marche pour les droits civiques est l’élément déclencheur d’une série d’attentats perpétrés par l’Irish Republican Army (IRA) qui ne prit réellement fin qu’au cours des années 1990.
Il va de soi qu’en ce qui concerne ce conflit intercommunautaire, tout comme celui à Tripoli, les religions érigées tels des préceptes sacrés, ne sont que des prétextes pour des luttes de pouvoir intestines et bassement politiques, la couronne d’Angleterre ne voulant céder aucune miette de son royaume et la République voisine, soutenue idéologiquement par le Vatican, n’ayant pas l’intention d’abandonner un vivier d’ouailles particulièrement dévouées.
Drapeaux et apologie des martyrs
D’après les actes officiels, la paix a été scellée entre les deux communautés le 10 avril 1998, enregistrant un bilan de 3 500 victimes, mais le désarmement effectif des partis s’est étendu sur une dizaine d’années (les derniers l’ont fait en 2009)
Six étés plus tard, en juillet 2015, je m’engage sur les routes d’Ulster à la recherche d’éventuels vestiges de cette ère de fer, ne pensant recueillir que quelques témoignages, tout au plus. Et pourtant, j’y ai non seulement trouvé des stigmates corrodés par le temps, mais surtout des marques encore fraîches de haine ambiante. Cela commence par des quartiers entiers tapissés de drapeaux aux couleurs de l’Union Jack avec des slogans de type « British and proud », alors que deux rues plus loin l’orange, le blanc et le vert de l’Irlande républicaine cisaillent le ciel gris avec irrévérence.
En pénétrant dans les anciens quartiers chauds de Belfast, eux aussi relégués à la périphérie, mais Ouest ce coup-ci, des étendards noirs rendent grâce aux morts en s’échouant le long des lampadaires et attendant qu’une légère brise viennent réveiller le passé et glorifier leur mémoire. A Tripoli le noir symbolise également l’hommage aux martyrs, mais lorsqu’il est accompagné d’une signature blanche aux consonances d’al shahâdatân, la profession de foi de l’Islam, il veut attester de l’existence du Dieu Unique. L’usage de ce drapeau est désormais dévolu aux groupes islamistes et djihadistes tels que Daesh, le Front Al Nosra, Aqmi, etc.
Les personnes mortes pour défendre leur cause sont donc, de part et d’autre du globe, élevées au rang de martyrs et considérées comme des symboles de soulèvement face à l’agresseur qui n’est pas dans le juste. Les fanions sont une première représentation de ces victimes mais pas les seuls. En effet, et là la différence d’époque a son importance, que ce soit en Irlande ou au Liban, il y a un besoin de les afficher qui passe par une technologie qui progresse avec son temps. A Belfast ou à Londonderry, deux communes majeures marquées par les Troubles, la photographie n’était pas aussi développée qu’aujourd’hui pour tirer des portraits géants à placarder entre deux rambardes d’immeubles, c’est pourquoi d’imposants murals ont été peints sur les façades des maisons. Les visages idéalisés des martyrs resteront ainsi gravés à jamais dans le marbre des consciences, alors que la société de consommation des années 2000 ne craint pas de voir s’effilocher le support papier puisqu’en un clic sera lancée une nouvelle impression.
Résolution d’un conflit : ségréger pour avoir la paix
L’extrême lourdeur des relations entre unionistes et nationalistes dans la capitale nord-irlandaise a mené à des résolutions drastiques qui paraissent de prime abord anti-pédagogiques. Comment croire en ces mesures si elles ne font que cacher la fracture qu’il y a en-dessous ? C’est la question que je me posais après avoir rencontré Florine Ballif et je trouvais désolant d’aller jusqu’à construire un mur pour avoir la paix. Il en était alors de même pour toutes les situations de ségrégation par l’espace qui visent à éviter la rencontre et favorise l’entre-soi. Mais j’admets qu’après quelques mois de tâtonnements à Tripoli, je ne trouve plus l’idée aussi ahurissante et je me suis même entendue dire : « Mais séparez-les puisqu’ils se maudissent ! ».
Réflexion faite et tour d’horizon en Irlande du Nord terminé, la girouette a virevolté une troisième fois, à 90°. Une solution d’entre-deux me paraitrait donc plus adéquate car elle éviterait le cloisonnement qui, temporairement est sans doute une solution efficace, mais sur le long terme ne permet pas de rouvrir un dialogue qui s’est complètement rompu. Ainsi, si l’isolement géographique est nécessaire pour ne pas craindre de se faire tuer par un sniper il n’est pas non plus recommandable à 100%. Je ne me hasarderai pas à trouver la solution qui mettrait fin à tous les conflits communautaires, néanmoins j’espère avoir ouvert la voie à une discussion qui ne jugerait pas absurde toute idée de rupture urbaine et humaine pour des cas d’impossibilité viscérale de communiquer.
|
Table des matières
REMERCIEMENTS
TABLE DES MATIERES
Premier regard biaisé : Posture de départ
Première partie : CADRE CONCEPTUEL
Section 1 – Le communautarisme
1. Distinction communauté et communautaire
2. Sunnisme VS chiisme
3. Le Liban, un Etat multicommunautaire
4. La notion de société civile
Section 2 – La géographie des conflits
1. Reconnaître et appréhender un conflit
2. Les géographies en support
Seconde partie : CONTEXTUALISATION
1. La guerre civile en Syrie : diviser pour mieux régner
2. Rappels historiques au Liban
3. Construction d’un territoire et scission en deux quartiers autonomes
Troisième partie : METHODOLOGIE
1. La nécessité de l’auto-ethnographie
2. Une position préalable difficile à trouver
3. Une approche informelle du terrain
4. Evolution du sujet : du rêve à la réalité
5. Tentative de comparaison avec le conflit nord-irlandais
Quatrième partie : PRESENTATION DES ASSOCIATIONS TRIPOLITAINES
1. Ruwwad al tanmeya – Lebanon
2. Utopia
3. Offre Joie
4. Fondation Safadi
5. Médecins Sans Frontières
Cinquième partie : TRIPOLI, LES TRIPOLITAINS ET LES AUTRES
1. Etrange sentiment de bien-être à Tripoli
2. Une ville rassurante, mais pour qui ? Portraits de eux, de nous Second regard biaisé : Un mois au Liban
Sixième partie : ETUDE DE CAS : BAB EL TEBBANE ET JABAL MOHSEN, DEUX QUARTIERS DANS ET HORS DE TRIPOLI
1. Pauvreté et mise à l’écart par le reste de la ville
2. Terrain de recherche : accéder aux lieux, une aventure difficile et dangereuse
3. Adaptation forcée de l’espace : les remparts contre la guerre
4. Premières impressions d’un conflit
5. Jouer sur la ligne de front
Troisième regard biaisé : « La musique souvent me prend comme une mer »
6. Jabal Mohsen : un îlot sur la défensive
7. Bab el Tebbane et Jabal Mohsen : entre intégration et rejet de la ville
Septième partie : LA SURVIE DES QUARTIERS OPEREE PAR LA SOCIETE CIVILE
1. Quelles priorités face au tandem pauvreté/conflit ?
2. Quelles conclusions tirer de ces initiatives ?
Quatrième et dernier regard biaisé sur un des 38 conflits armés qui se déroulent actuellement dans le monde : Posture de retour
BIBLIOGRAPHIE
TABLES DES ILLUSTRATIONS
TABLE DES MATIERES
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet